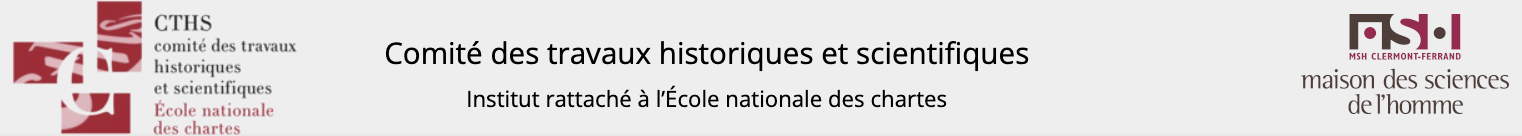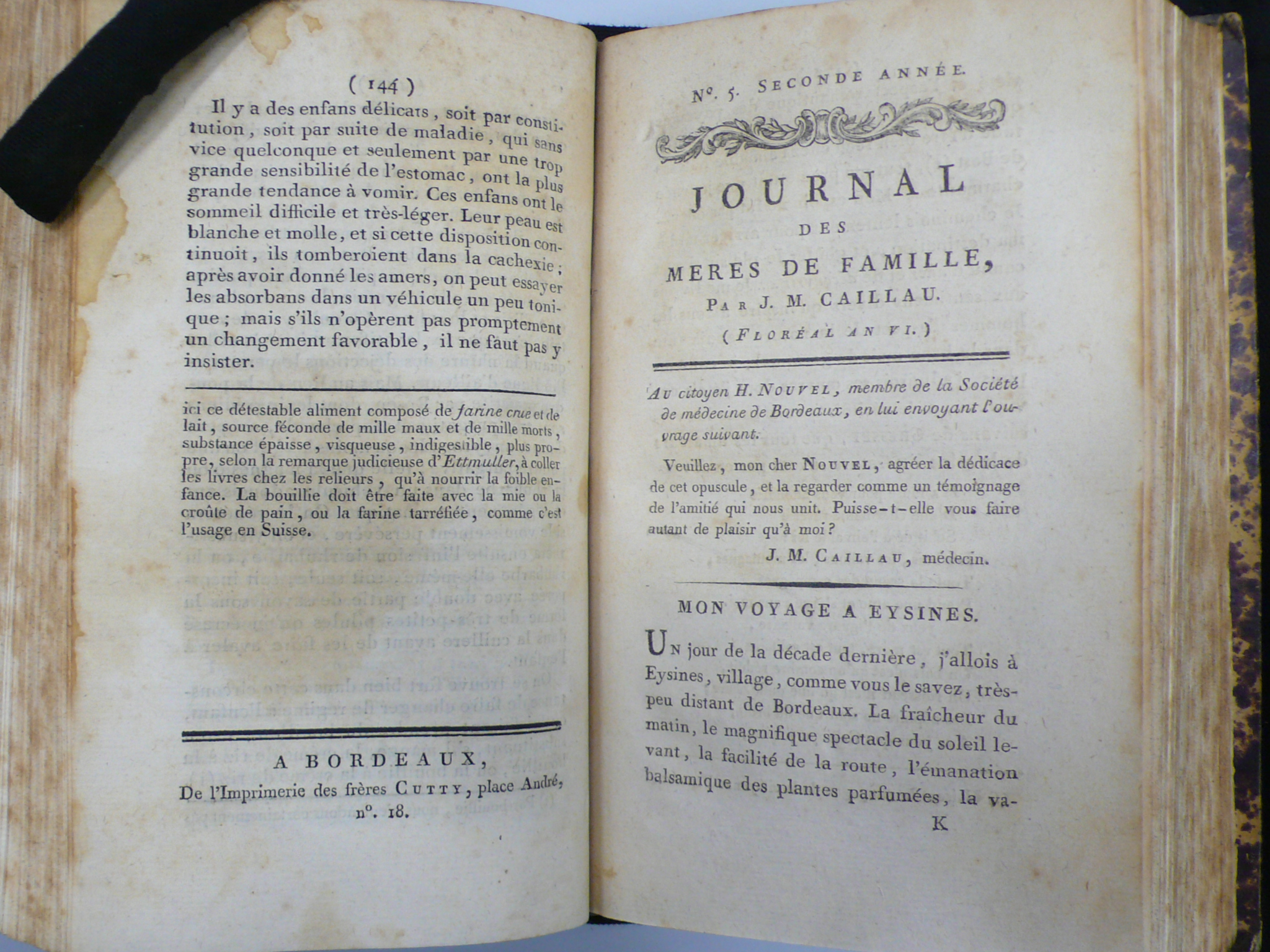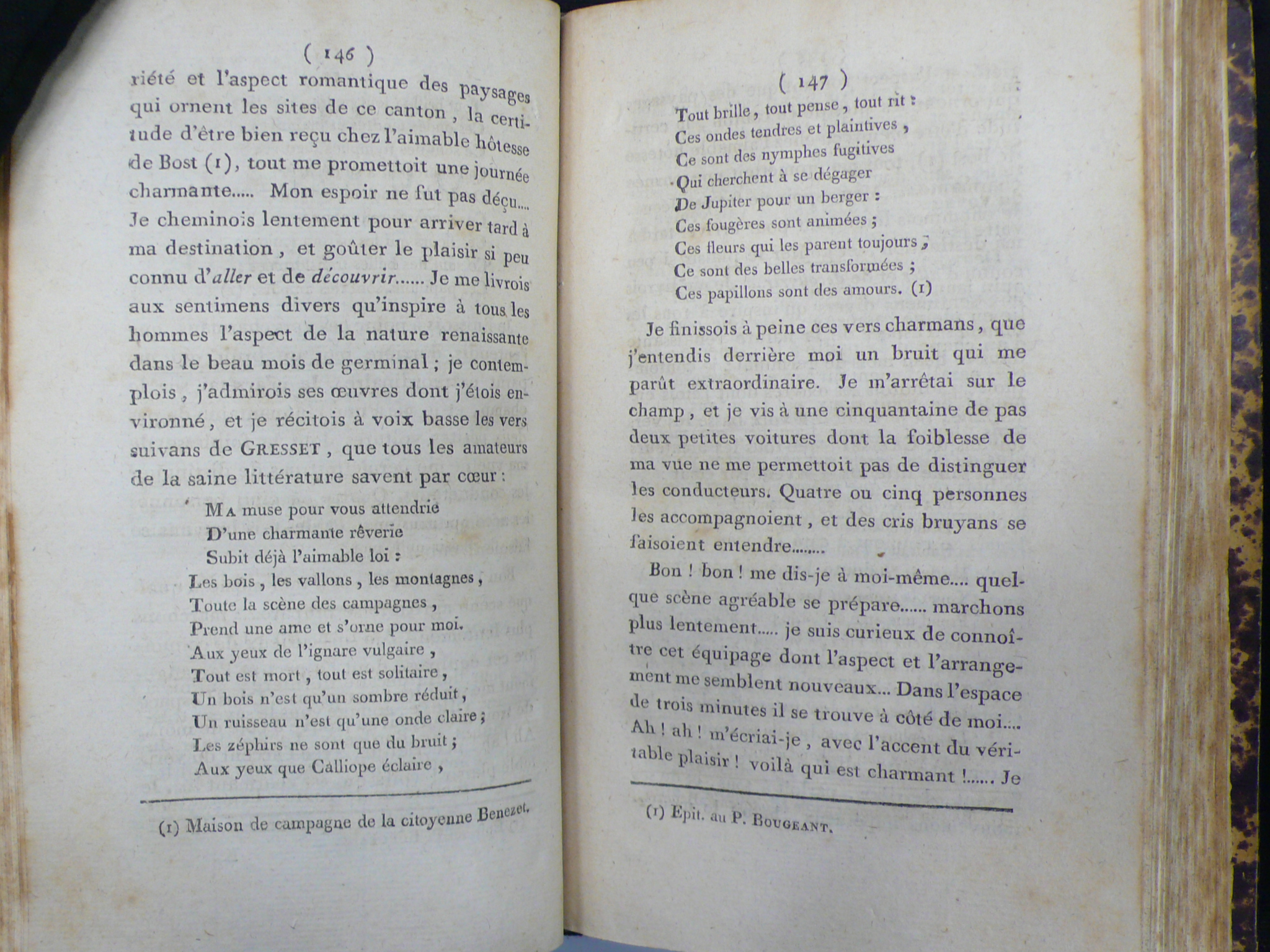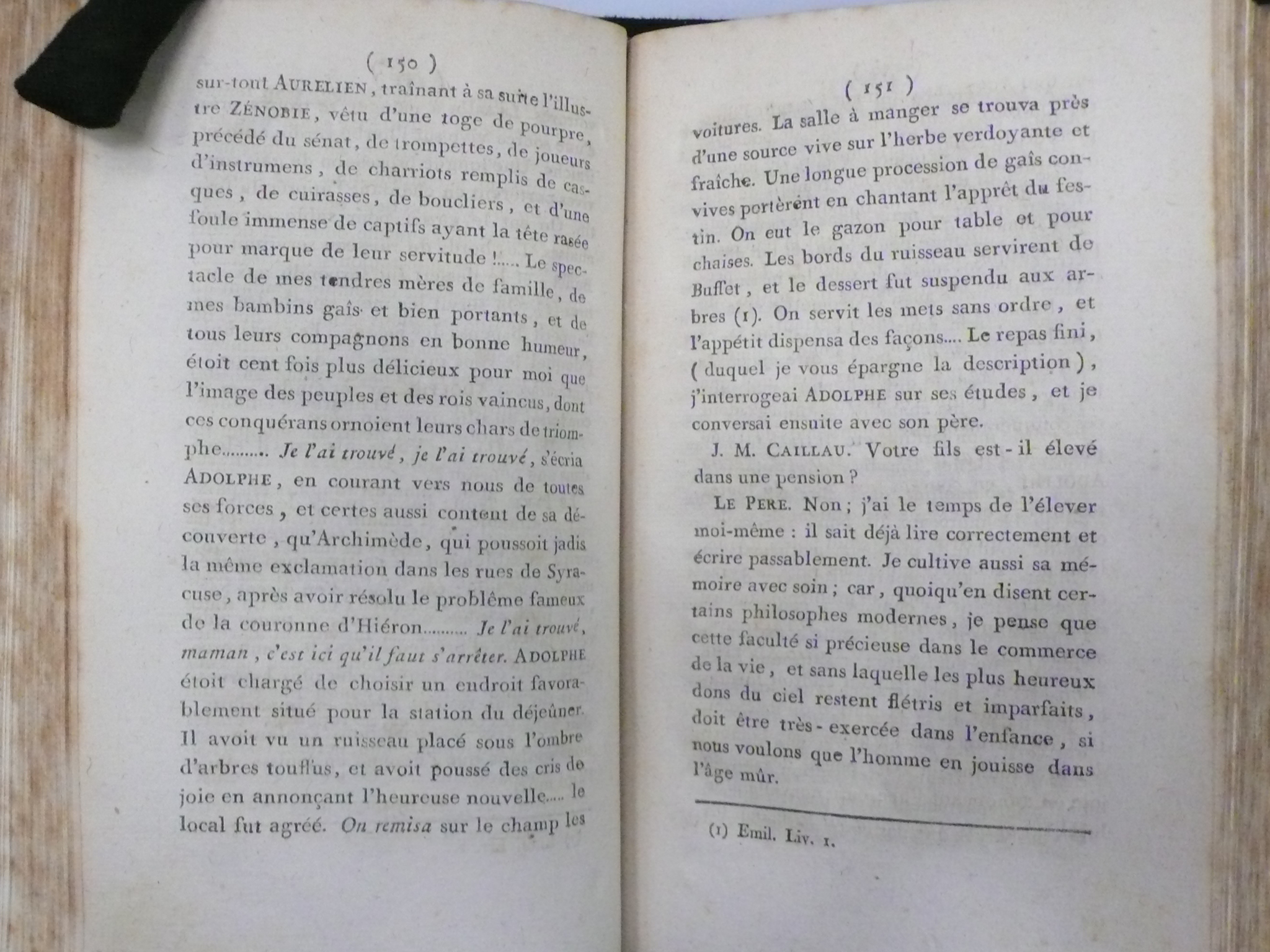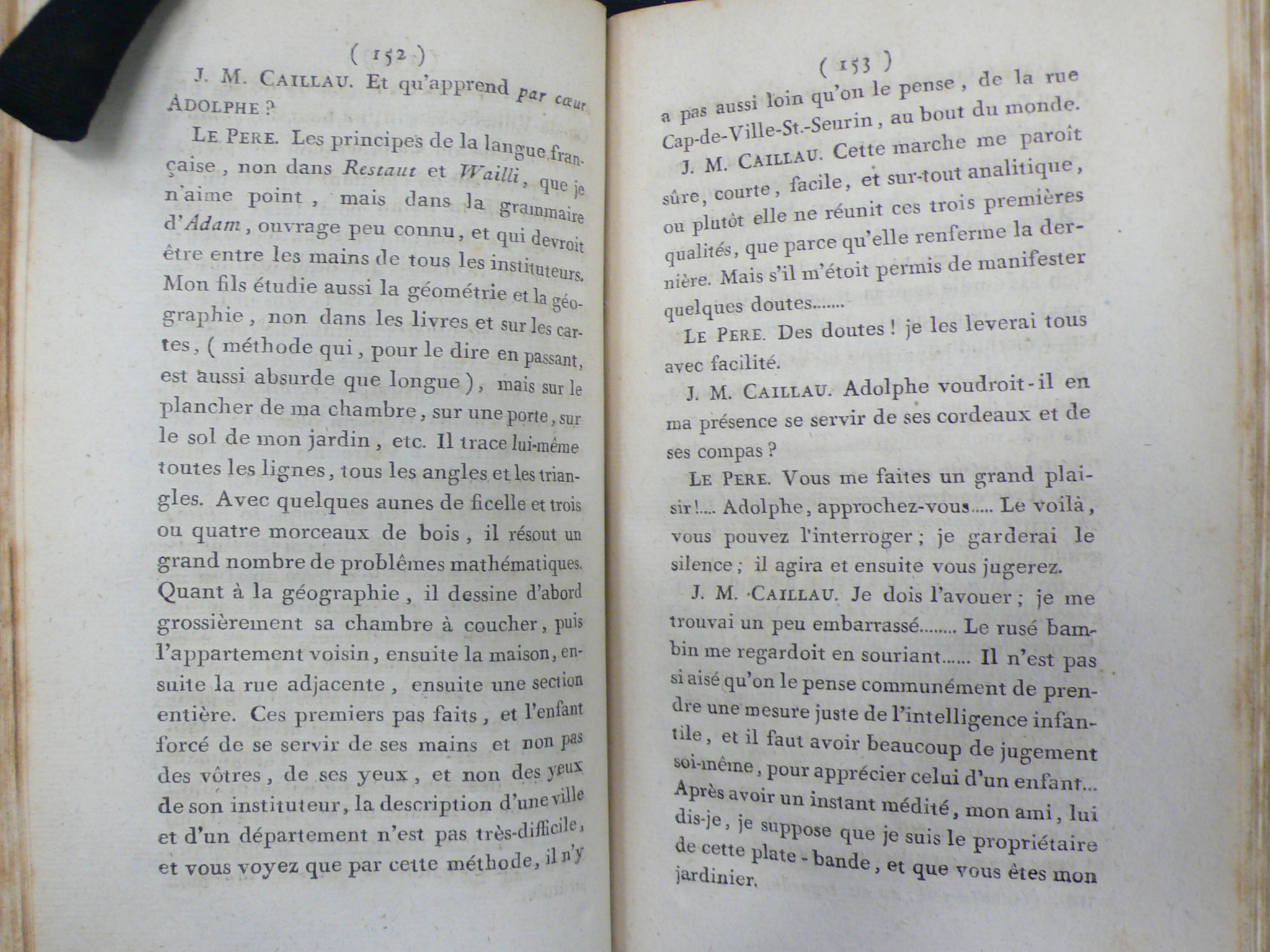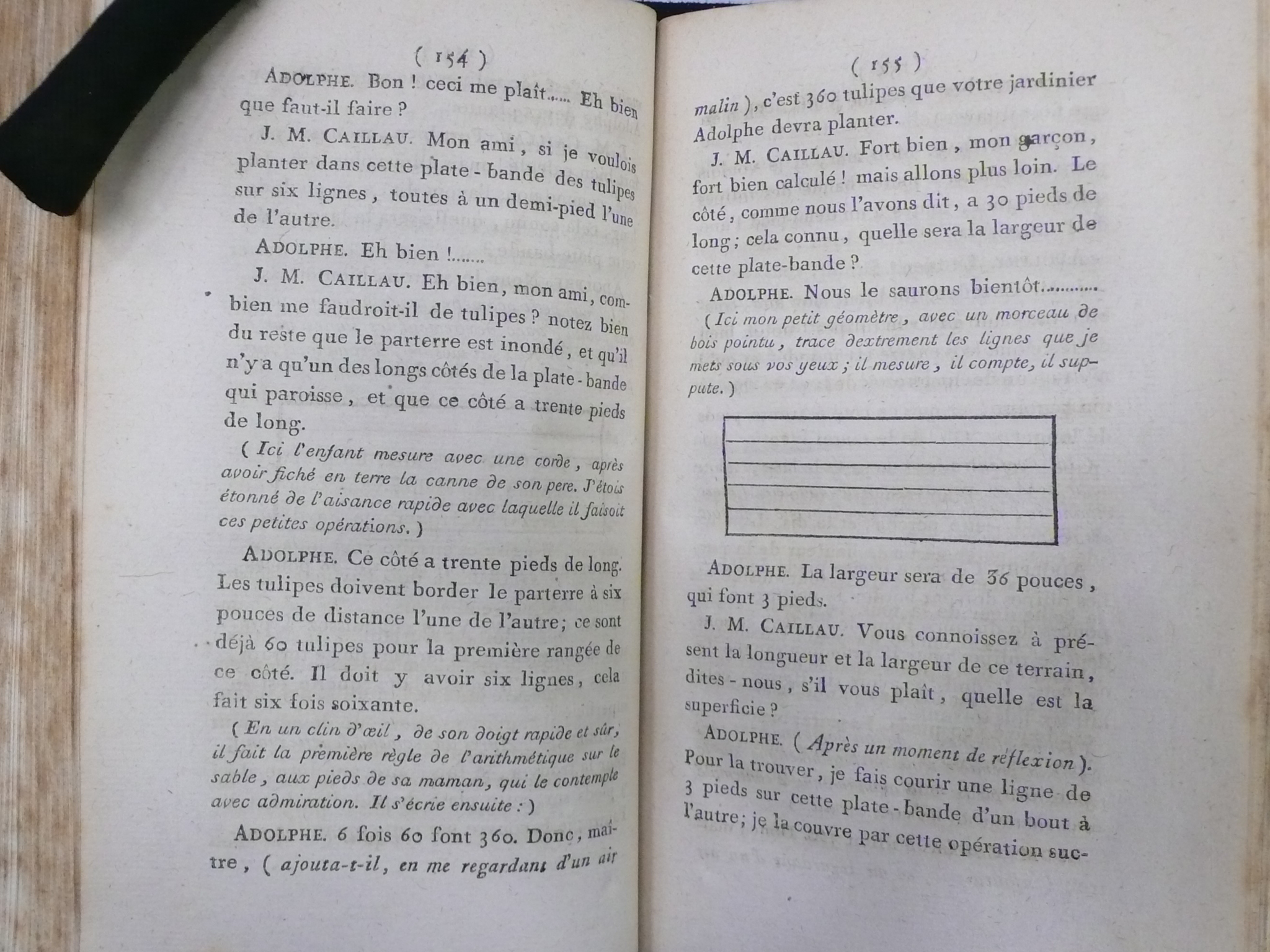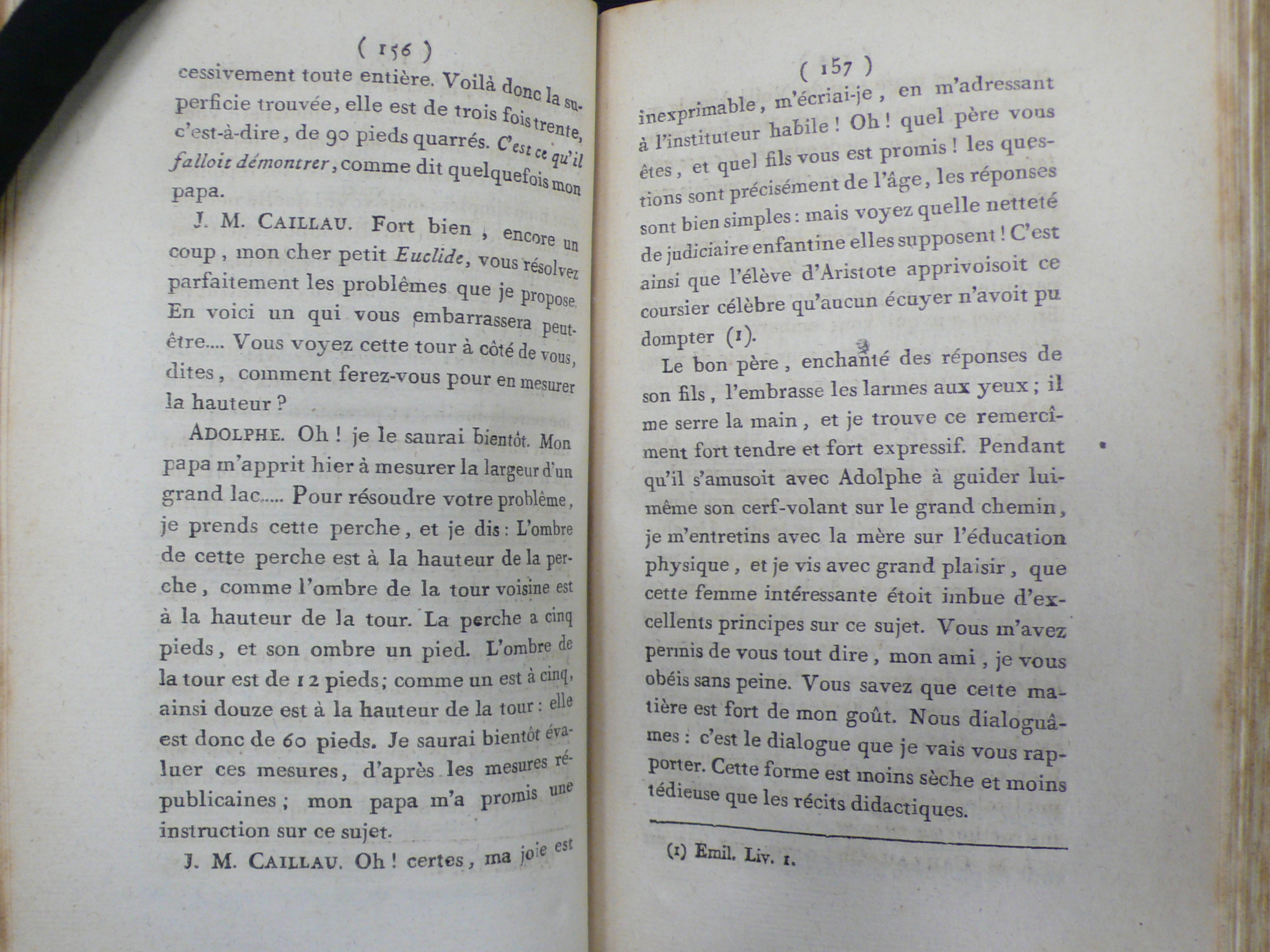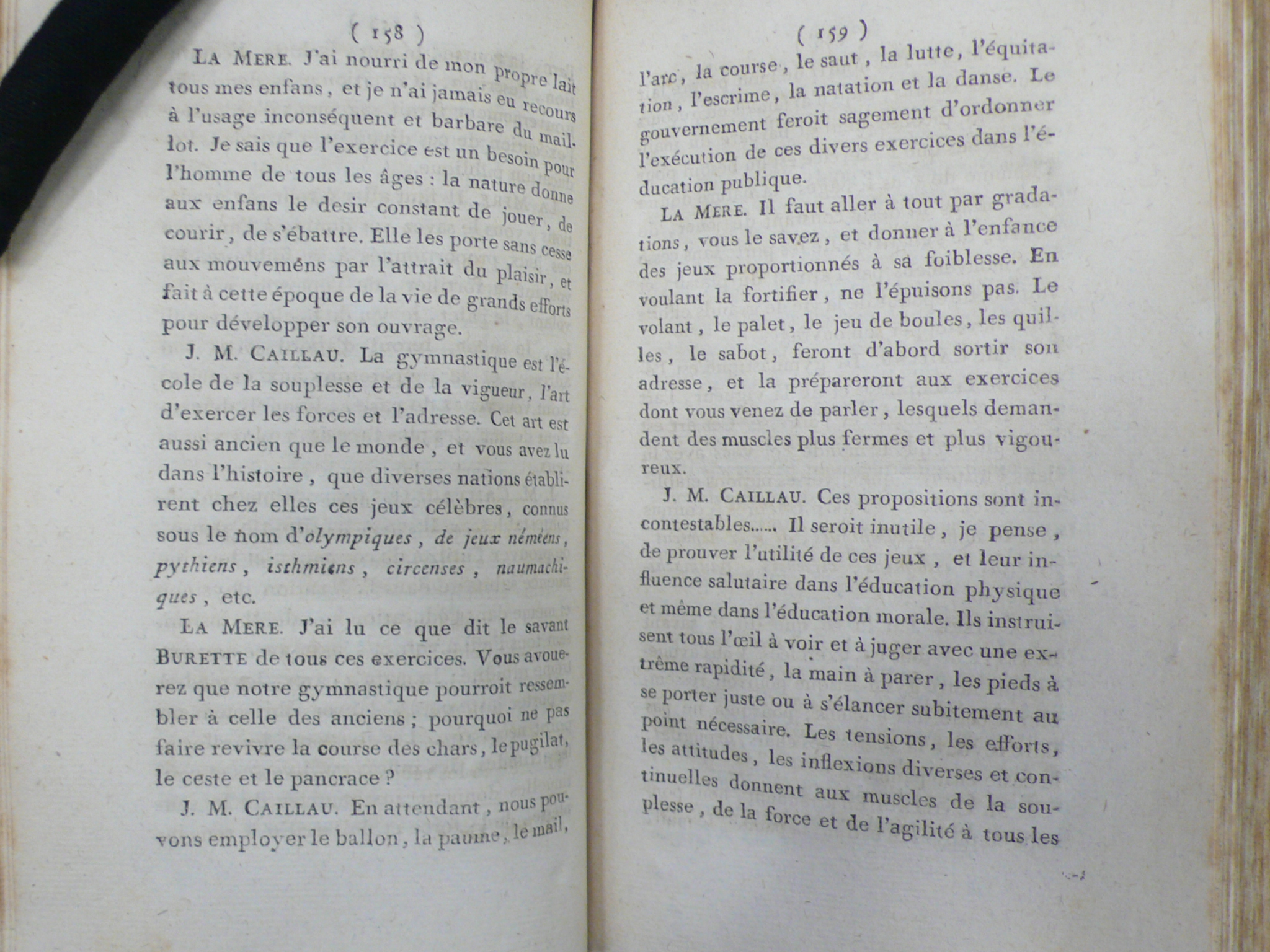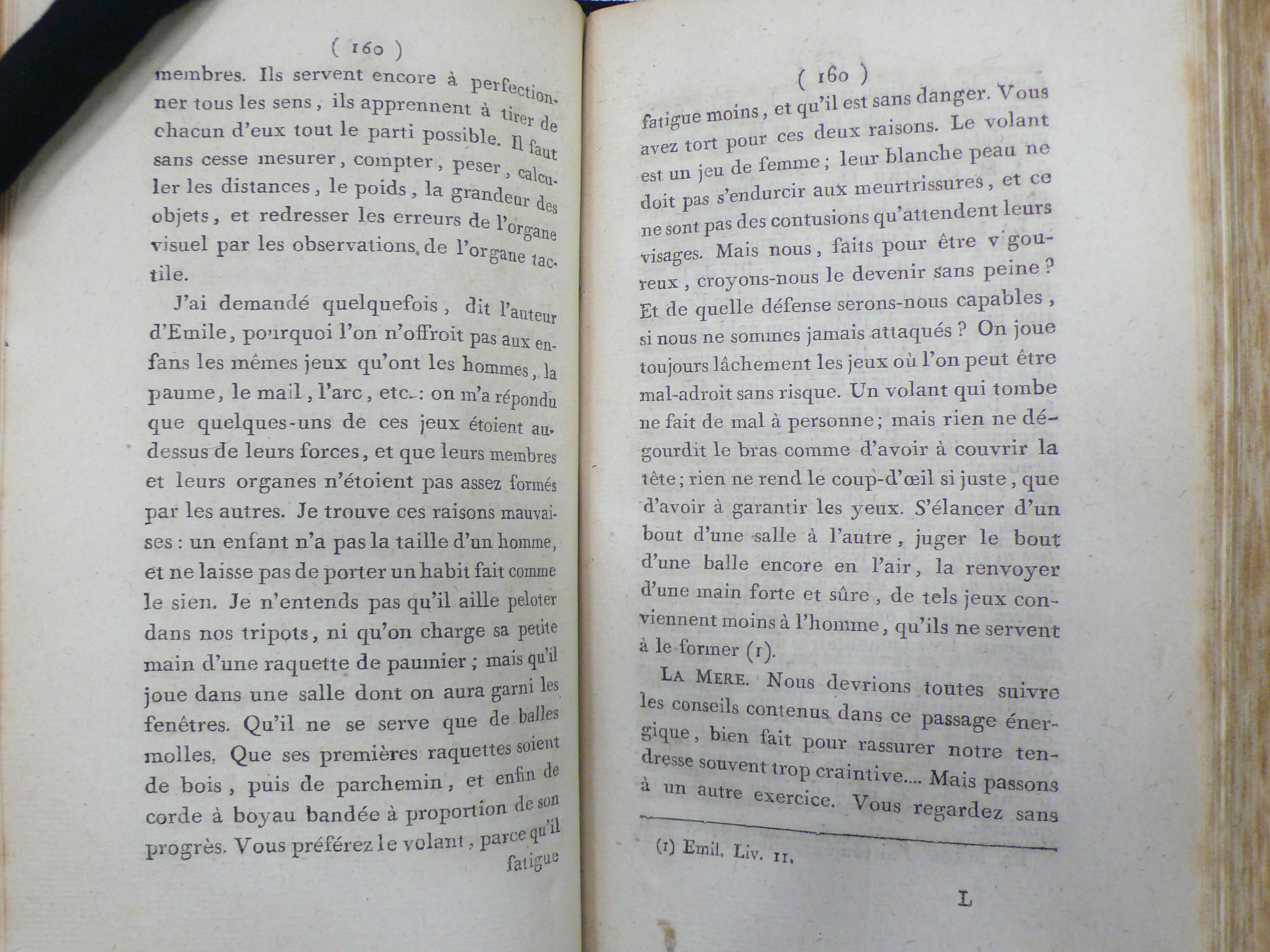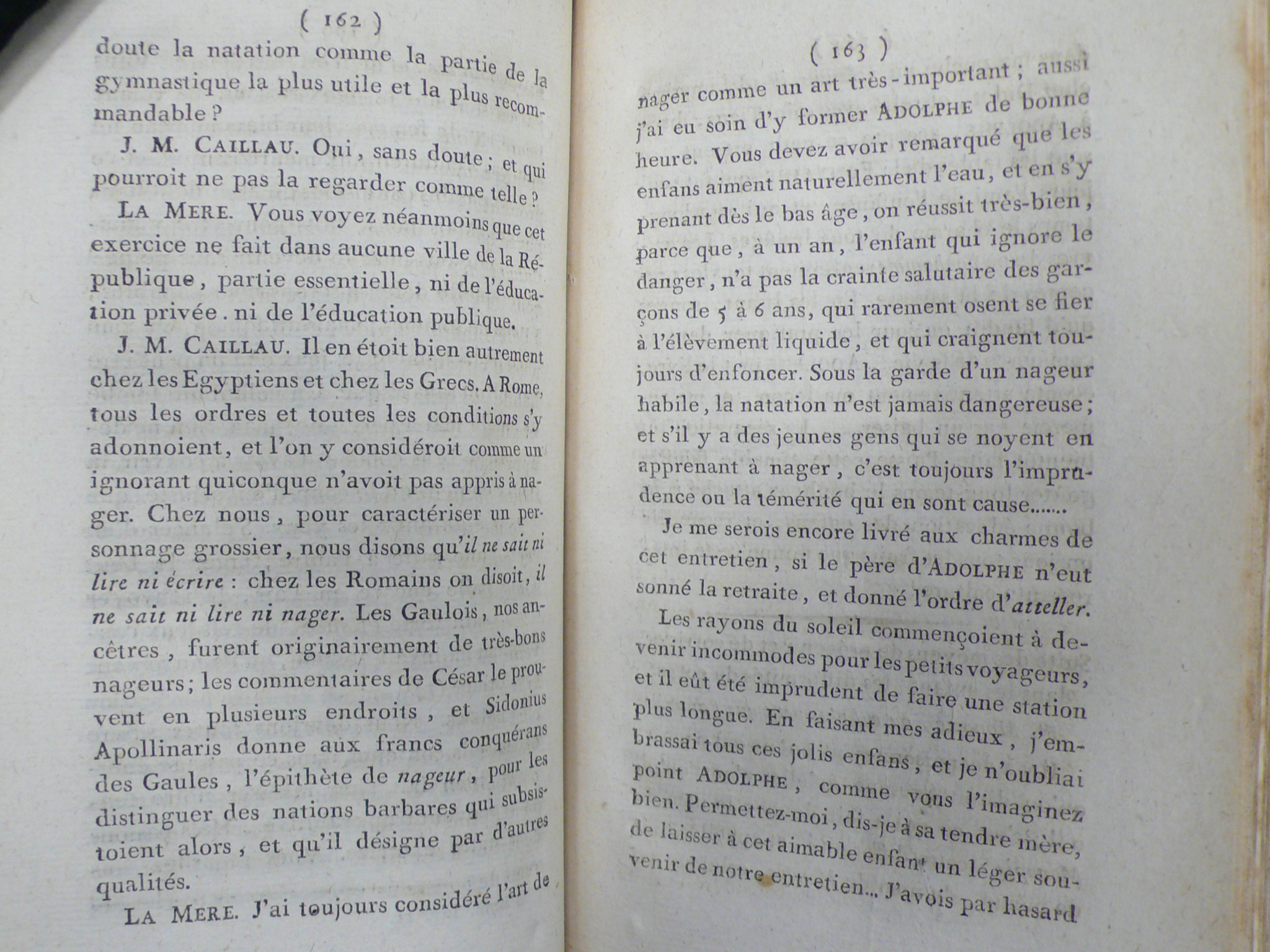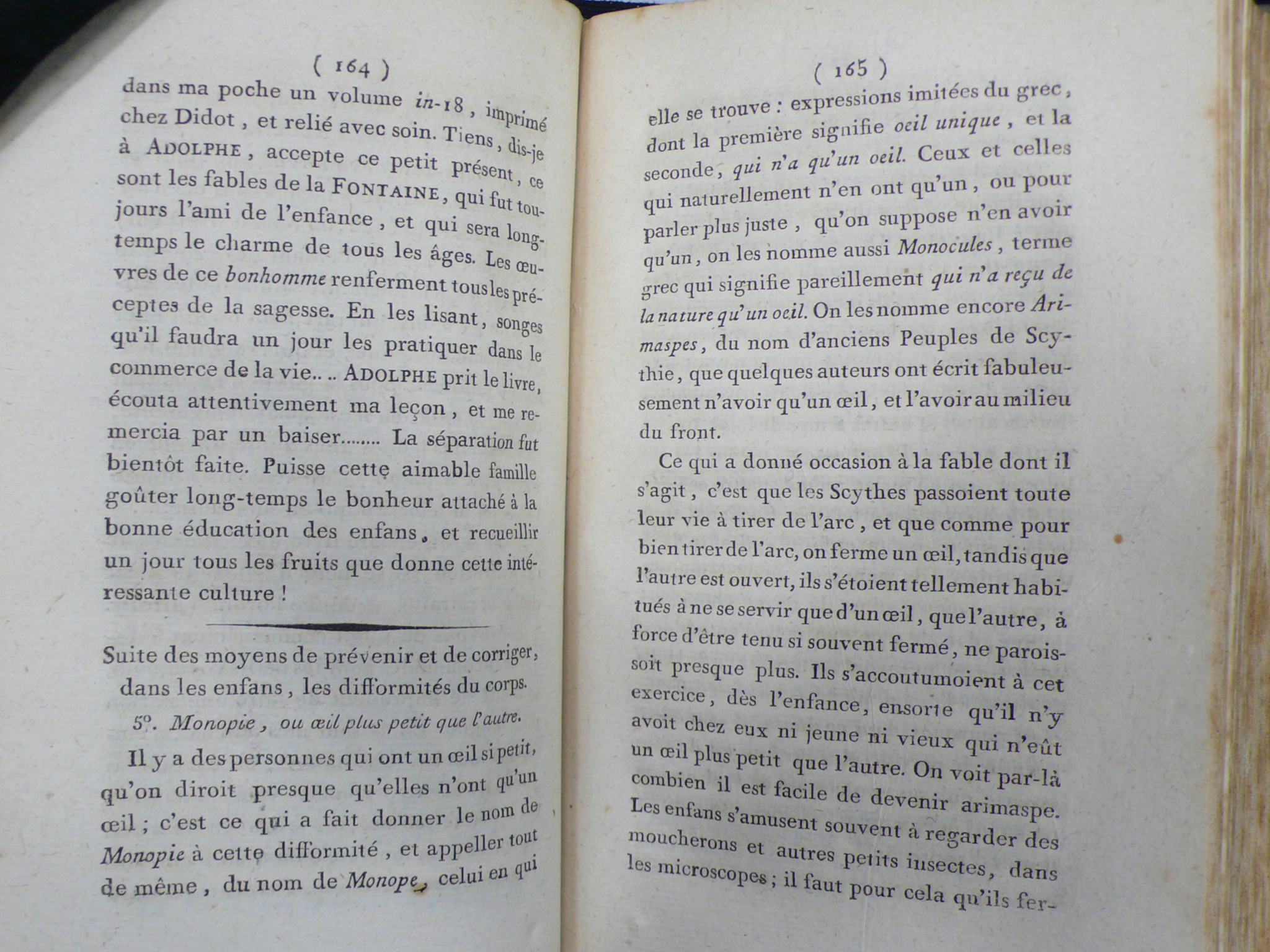Une pastorale pédagogique entre tradition et Révolution
Auteur
Année de publication
Thématique
Année du document
Présentation
À vue de pays, le Journal des mères de famille proposé à Bordeaux par Jean-Marie Caillau procède d’une démarche d’émancipation et d’instruction caractéristique des projets progressistes au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Ce médecin des hôpitaux militaires de Bordeaux et Bayonne, né en 1765 à Gaillac, allait devenir membre des sociétés de Médecine de Bordeaux, mais aussi de Paris et de Bruxelles, ou encore de la Société philomatique de Bordeaux. Il annonce dans le prospectus de cette feuille lancée le 12 nivôse an V (1er janvier 1797) sa volonté d’« instruire une classe nombreuse de citoyens » et de « détruire les préjugés du peuple ». Il entend « répandre tous les mois dans un ouvrage périodique, des instructions simples sur la manière d’élever ou de nourrir les enfans. C’est aux pères qui vivent éloignés du secours des villes, et qui comptent pour quelque chose la santé ferme et vigoureuse de leurs enfans ; c’est aux tendres mères de famille sur-tout que cet écrit sera destiné ». Ce journal participe à la diffusion des propositions formulées par Rousseau dans l’Émile (1762) pour une éducation en accord avec la nature – à la fois cadre champêtre où le petit d’homme gagne à grandir, revalorisation des relations familiales et respect dans l’enfant de l’être en devenir - afin de favoriser l’avènement d’un citoyen autonome et accompli. Jean-Marie Caillau défend avec constance l’intérêt de l’allaitement au sein maternel pour le plus grand bénéfice en matière de santé et de relations humaines des enfants et des mères, sans oublier le plaisir des pères. Il pourfend les idées reçues à propos du commerce que peuvent avoir les jeunes mères avec leurs époux, nullement empêché par l’allaitement. Il promeut l’exercice physique pour les jeunes filles et s’élève contre le port du corset. Il publie des historiettes tantôt tragiques, tantôt heureuses, illustrant les ravages commis par les usages délétères de l’emmaillotage, ou les avantages des soins domestiques apportés à leur progéniture par des parents aimants et éclairés. Les colonnes de ce journal qui relaye les adaptations par l’abbé Sicard, l’instituteur des sourds et muets, de la méthode syllabique mise au point par le pasteur Stuber en 1762, témoignent aussi d’une certaine perméabilité aux modes d’un temps qui, tout au long du siècle, de Montesquieu à Laclos, goûte le roman épistolaire – une forme jugée « moins sèche et moins tédieuse que les récits didactiques »1, puis en ses dernières décennies, la contemplation d’une nature remise à l’honneur. Ce « voyage à Eysines » présente ainsi l’Arcadie d’une sociabilité délivrée du carcan formaliste des conventions sociales dans le cadre simple et vrai d’un printemps bucolique, en cette époque sans nom à la charnière des Lumières et du romantisme.
Mais, à bien y regarder, l’églogue du docteur Caillau participe aux débats politiques ouverts par la Révolution où il défend une posture modérée. Prescrivant la progressivité au moment où il faut retirer les enfants de la nourrice, il généralise, assurant que « dans toutes les institutions humaines en politique, en morale, en éducation, tout changement subi est un mal ». Dans la délibération ouverte par le Plan d’éducation de Lepeletier, présenté par Robespierre le 29 juillet 1793, en manière de contre-feu aux vastes ambitions de Condorcet, le lendemain du rapport de Barère contre les Girondins, le Journal des mères de famille qui, parfois, date le jour en vieux style – discret signe de désapprobation des innovations révolutionnaires –, s’oppose à l’obligation scolaire et au placement des enfants à l’internat de maisons d’éducation d’inspiration fort spartiate2. Le personnage du père du garçon fictif, ici désigné par le prénom Adolphe alors en vogue, comme le confirmera quelques années plus tard le roman éponyme de Benjamin Constant, présente fièrement les résultats produits par une instruction paternelle soucieuse de rendre l’enfant acteur de sa formation et de recourir aux ressorts de la curiosité et du plaisir, mais il discute aussi les affirmations de « certains philosophes modernes ». Caillau fait allusion au livre II de l’Émile où Rousseau, s’élevant contre l’usage de faire apprendre aux enfants « des noms de rois, des dates, des termes de blason, de sphère, de géographie et tous ces mots sans aucun sens pour son âge et sans utilité pour aucun âge que ce soit ». À rebours de la remise en cause d’une érudition jugée inutile par Rousseau, le bon docteur émaille son dialogue de références antiques, manière de défendre une représentation classique ce que doit être le savoir, et de pratiquer la distinction culturelle. Le don au jeune Adolphe des Fables de La Fontaine à la fin du « Voyage » apparaît encore un coup de griffe au citoyen de Genève. Dans une société s’accommodant d’un vote conjugalisé pour les femmes, nul de s’étonnera enfin au spectacle de ce bon mari prenant en charge l’instruction scientifique de son fils, tandis que sont assignés à la mère la néonatologie, le jeu et l’activité physique, propres à sa « nature » en vertu d’une répartition genrée des compétences et des tâches.
Cette littérature pédagogique assez banale est riche précisément de son manque d’originalité, par ce qu’elle dit de la très ample diffusion de l’influence rousseauiste, et des réticences que suscite l’obligation scolaire dans des structures étatiques nationales, acquise un siècle plus tard au début de la IIIe République.
Transcription
Extraits du Journal des mères de famille, B.M. Bordeaux, Ms 713 (2) XXX, prospectus, et B 10 716, n°5 de la seconde année, floréal an VI (avril 1797)
Un jour de la décade dernière, j’allois à Eysines, village, comme vous le savez, très-peu distant de Bordeaux. La fraîcheur du matin, le magnifique spectacle du soleil levant, la facilité de la route, l’émanation balsamique des plantes parfumées, la variété et l’aspect romantique des paysages qui ornent les sites de ce canton, la certitude d’être bien reçu […], tout me promettoit une journée charmante… Mon espoir ne fut pas déçu… Je cheminois lentement pour arriver tard à ma destination, et goûter le plaisir si peu connu d’aller et de découvrir… Je me livrois aux sentiments divers qu’inspire à tous les hommes d’aspect de la nature renaissante dans le beau mois de germinal […] J’entendis derrière moi un bruit qui me parût extraordinaire. Je m’arrêtais sur le champ, et je vis à une cinquantaine de pas deux petites voitures dont la foiblesse de ma vue ne me permettoit pas de distinguer les conducteurs. Quatre ou cinq personnes les accompagnoient, et des cris bruyants se faisaient entendre… […] Deux femmes charmantes, vêtues de nanquin jaune clair (dont la couleur est si jolie en pleine campagne), la tête couverte d’un chapeau de paille à la glaneuse, placées parallèlement sur le grand chemin, trainoient en riant deux petits enfants de 18 mois, beaux comme l’amour, qui rioient plus qu’elles, assis sur ces petites voitures de vois peint, que prépare très-artistement le tourneur du chapeau-Trompette. Deux bonnes se tenoient à côté du chariot, pour surveiller sans doute les accidents imprévus. Deux citoyens (les pères des deux enfans) les suivoient de près, et touchoient de temps en temps les conductrices d’une petite gaule, pour imiter l’action des cochers et faire rire les petits bambins. Un troisième enfant âgé de six ou sept ans, légèrement vêtu, alloit à droite, à gauche, devant, derrière, parloit à tous, et de ses mouvemens impétueux, hâtoit le mouvement des chars qui marchoient trop-lentement sans doute, au gré de son active impatience…Vous croirez sans peine, mon cher ami, que la connoissance et la conversation furent bientôt liées entre ces voyageurs et moi. […] Nous marchâmes tous ensemble pendant un quart d’heure, ne nous occupant que du plaisir de ces petites créatures, dont les mamans et les papas trainoient tour à tour l’équipage… O heureuse enfance ! disois-je à moi-même ! heureuse époque de la vie, où le véritable rire est si souvent sur les lèvres et à l’ame est toujours en paix ! âge si aimable et si aimant, dont toutes les sensations sont affectives et douces, et qui, avec peu de chose, sait à chaque instant jouir beaucoup, résultat heureux et rare de toute philosophie !... En voyant marcher lentement les modestes voitures dont je vous ai crayonné le tableau, mon imagination qui aime les contrastes, se reportoit vers les temps de l’ancienne Rome, et faisoit d’agréables comparaisons. […] Le spectacle de mes tendres mères de famille, de mes bambins gais et bien portants, et de tous leurs compagnons en bonne humeur, étoit cent fois plus délicieux pour moi que l’image des peuples et des rois vaincus, dont ces conquérants ornoient leurs chars de triomphe… Je l’ai trouvé, je l’ai trouvé, s’écria Adolphe, en courant vers nous de toutes ses forces […] Adolphe étoit chargé de choisir un endroit favorablement situé pour la station du déjeuner. Il avoit vu un ruisseau placé sous l’ombre d’arbres touffus, et avoit poussé des cris de joie en annonçant l’heureuse nouvelle… Le local fut agréé. On remisa sur le champ les voitures. La salle à manger se trouva près d’une source vive sur l’herbe verdoyante et fraîche. Une longue procession de gais convives portèrent en chantant l’apprêt du festin. On eut le gazon pour table et pour chaises. Les bords du ruisseau servirent de buffet, et le dessert fut suspendu aux arbres3. On servit les mets sans ordre, et l’appétit dispensa des façons… Le repas fini […], j’interrogeai Adolphe sur ses études, et je conversai ensuite avec son père.
J.M. Caillau : Votre fils est-il élevé dans une pension ?
Le père : Non, j’ai le temps de l’élever moi-même : il sait déjà lire correctement et écrire passablement. Je cultive aussi sa mémoire avec soin ; car, quoiqu’en disent certains philosophes modernes, je pense que cette faculté est si précieuse dans le commerce de la vie, et sans laquelle les plus heureux dons du ciel restent flétris et imparfaits, doit être exercée dans l’enfance, si vous voulons que l’homme en jouisse dans l’âge mûr.
J.M. Caillau : Et qu’apprend par cœur Adolphe ?
Le père : les principes de la langue française, non dans Restau et Wailli, que je n’aime point, mais dans la grammaire d’Adam, ouvrage peu connu et qui devroit être entre les mains de tous les instituteurs. Mon fils étudie aussi la géométrie et la géographie, non dans les livres et sur les cartes (méthode qui, pour le dire en passant, aussi absurde que longue), mais sur le plancher de ma chambre, sur une porte, sur le sol de mon jardin, etc. Il trace lui-même toutes les lignes, tous les angles et les triangles. Avec quelques années de ficelle et trois ou quatre morceaux de bois, il résout un grand nombre de problèmes mathématiques. Quant à la géographie, il dessine d’abord grossièrement sa chambre à coucher, puis l’appartement voisin, ensuite la maison, ensuite la rue adjacente, ensuite une section entière. Ces premiers pas faits, et l’enfant forcé de se servir de ses mains et non pas des vôtres, de ses yeux, et non pas des yeux de son instituteur, la description d’une ville et d’un département n’est pas très-difficile, et vous voyez que par cette méthode, il n’y a pas aussi loin qu’on le pense, de la rue Cap-de-ville Saint-Seurin, au bout du monde.
J.M. Caillau : Cette marche me paroît sûre, courte, facile et sur-tout analitique, ou plutôt elle ne réunit ces trois premières qualités que parce qu’elle renferme la dernière. Mais s’il m’étoit permis de manifester quelques doutes…
Le père : Des doutes ! Je les lèverai tous avec facilité.
J.M. Caillau : Adolphe voudroit-il en ma présence se servir de ses cordeaux et de ses compas ?
Le père : Vous me faites un grand plaisir !... Adolphe, approchez-vous… Le voilà, vous pouvez l’interroger ; je garderai le silence ; il agira et ensuite vous jugerez.
J.M. Caillau : Je dois l’avouer ; je me trouvois un peu embarrassé… Le rusé bambin me regardoit en souriant… Il n’est pas si aisé qu’on le pense communément de prendre une mesure juste de l’intelligence infantile, et il faut beaucoup de jugement soi-même pour apprécier celui d’un enfant…Après avoir un instant médité, mon ami, lui dis-je, je suppose que je suis le propriétaire de cette plate-bande, et que vous êtes mon jardinier.
Adolphe : Bon ! ceci me plait… Eh bien, que faut-il faire ?
J.M. Caillau : Mon ami, si je voulois planter dans cette plate-bande des tulipes sur six lignes, toutes à demi-pied l’une de l’autre…
Adolphe : Eh bien ?...
J.M. Caillau : Eh bien, mon ami, combien me faudroit-il de tulipes ? Notez bien du reste que le parterre est inondé, et qu’il n’y a qu’un des longs côtés de la plate-bande qui paroisse, et que ce côté a trente pieds de long.
Ici l’enfant mesure avec une corde, après avoir fiché en terre la canne de son père. J’étois étonné de l’aisance rapide avec laquelle il faisoit ces petites opérations.
Adolphe : Ce côté a trente pieds de long. Les tulipes doivent border le parterre à six pouces de distance l’une de l’autre ; ce sont déjà soixante tulipes pour la première rangée de ce côté. Il doit y avoir six lignes, cela fait six fois soixante.
En un clin d’œil, de son doigt rapide et sûr, il fait la première règle de l’arithmétique sur le sable, aux pieds de sa maman, qui le contemple avec admiration. Il s’écrie ensuite :
Adolphe : 6 fois soixante font 360. Donc, maître, ajouta-t-il en me regardant d’un air malin, c’est 360 tulipes que votre jardinier Adolphe devra planter.
J.M. Caillau : Fort bien, mon garçon, fort bien calculé ! mais allons plus loin. Le côté, comme nous l’avons dit, a 30 pieds de long ; cela connu, quelle sera la largeur de cette plate-bande ?
Adolphe : Nous le saurons bientôt…
Ici mon petit géomètre, avec un morceau de bois pointu, trace dextrement les lignes […] ; il mesure, il compte, il suppute.
Adolphe : La largeur sera de 36 pouces, qui font 3 pieds.
J.M. Caillau : Vous connoissez à présent la longueur et la largeur de ce terrain, dites-nous, s’il vous plaît, quelle est sa superficie ?
Adolphe (après un moment de réflexion) : Pour la trouver, je fais courir une ligne de 3 pieds sur cette plate-bande d’un bout à l’autre ; je la couvre par cette opération successivement toute entière. Voilà donc la superficie trouvée, elle est trois fois trente, c’est à dire de 90 pieds quarrés. C’est ce qu’il falloit démontrer, comme dit quelquefois mon papa.
J.M. Caillau : Fort bien, encore un coup, mon cher petit Euclide, vous résolvez parfaitement les problèmes que je propose. En voici un qui vous embarrassera peut-être… Vous voyez cette tour à côté de vous, dites, comment ferez-vous pour en mesurer la hauteur ?
Adolphe : Oh ! je le saurai bientôt. Mon papa m’apprit hier à mesurer la largeur d’un grand lac… Pour résoudre votre problème, je prends cette perche, et je dis : l’ombre est à la hauteur de la perche, comme l’ombre de la tour voisine est à la hauteur de la tour. La perche a cinq pied et son ombre un pied. L’ombre de la tour est de 12 pieds ; comme un est à cinq, ainsi douze est à la hauteur de la tour ; elle est donc de 60 pieds. Je saurai bientôt évaluer ces mesures, d’après les mesures républicaines ; mon papa m’a promis une instruction sur ce sujet.
J.M. Caillau : Oh ! certes ma joie est inexprimable, m’écriai-je, en m’adressant à l’instituteur habile ! Oh ! quel père vous êtes, et quel fils vous est promis ! les questions sont précisément de l’âge, les réponses sont bien simples : mais voyez quelle netteté de jugement enfantine elles supposent ! […]
Le bon père, enchanté des réponses de son fils, l’embrasse les larmes aux yeux : il me serre la main, et je trouve ce remerciement fort tendre et fort expressif. Pendant qu’il s’amusoit avec Adolphe à guider lui-même son cerf-volant sur le grand-chemin, je m’entretins avec la mère sur l’éducation physique, et je vis avec plaisir que cette femme intéressante étoit imbue d’excellents principes sur le sujet. […]
La mère : J’ai nourri de mon propre lait tous mes enfans, et je n’ai jamais eu recours à l’usage inconséquent et barbare du maillot. Je sais que l’exercice est un besoin pour l’homme de tous les âges : la nature donne aux enfans le désir constant de jouer, de courir, de s’ébattre. Elle les porte sans cesse aux mouvements par l’attrait du plaisir, et fait à cette époque de la vie de grands efforts pour développer son ouvrage.
J.M. Caillau : La gymnastique est l’école de la souplesse et de a vigueur, l’art d’exercer les forces et l’adresse. Cet art est aussi ancien que le monde, et vous avez lu dans l’histoire que diverses nations établirent chez elles ces jeux célèbres […] …
La mère : j’ai lu ce que dit le savant Burette de tous ces exercices. Vous avouerez que notre gymnastique pourroit ressembler à celle des anciens ; pourquoi ne pas faire revivre la course des chars, le pugilat, le ceste et le pancrace ?
J.M. Caillau : En attendant, nous pouvons employer le ballon, la paume, le mail, l’arc, la course, le saut, la lutte, l’équitation, l’escrime, la natation et la danse. Le gouvernement feroit sagement d’ordonner l’exécution de ces divers exercices dans l’éducation publique.
La mère : il faut aller à tout par gradation, vous le savez, et donner à l’enfance des jeux proportionnés à sa foiblesse. En voulant la fortifier, ne l’épuisons pas. Le volant, le palet, le jeu de boule, les quilles, le sabot, feront d’abord sortir son adresse, et la prépareront aux exercices dont vous venez de parler, lesquels demandent des muscles plus fermes et plus vigoureux.
J.M. Caillau : ces propositions sont incontestables… Il seroit inutile, je pense, de prouver l’utilité de ces jeux, et leur influence salutaire dans l’éducation physique et même dans l’éducation morale. Ils instruisent tous l’œil à voir et à juger avec une extrême rapidité, la main à parer, les pieds à se porter juste ou à s’élancer subitement au point nécessaire. Les tensions, les efforts, les attitudes, les inflexions diverses et continuelles donnent aux muscles de la souplesse, de la force et de l’agilité à tous les membres. Ils servent encore à perfectionner tous les sens, ils apprennent à tirer de chacun d’eux tout le parti possible. Il faut cesse mesurer, compter, peser, calculer les distances, le poids, la grandeur des objets, et redresser les erreurs de l’organe visuel par les observations de l’organe tactile.
J’ai demandé quelquefois, dit l’auteur d’Emile, pourquoi l’on n’offroit pas aux enfans les mêmes jeux qu’ont les hommes, la paume, le mail, l’arc, etc. On m’a répondu que quelques-uns de ces jeux étoient au-dessus de leurs forces, et que leurs membres et leurs organes n’étoient pas assez formés par les autres. Je trouve ces raisons mauvaises : un enfant n’a pas la taille d’un homme, et ne laisse pas de porter un habit fait comme le siens. Je n’entends pas s’il aille peloter dans nos tripots, ni qu’on charge sa petite main d’une raquette de paumier ; mais qu’il joue dans une salle dont on aura garni les fenêtres. Qu’il ne se serve que de balles moelles. Que ses premières raquettes soient de bois, puis de parchemin, et enfin de corde à boyau bandée à proportion de son progrès. Vous préférez le volant, parce qu’il fatigue moins, et qu’il est sans danger. Vous avez tort pour ces deux raisons. Le volant est un jeu de femmes ; leur blanche peau ne doit pas s’endurcir aux meurtrissures, et ce ne sont pas des contusions qu’attendent leurs visages. Mais nous, faits pour être vigoureux, croyons-nous le devenir sans peine ? Et de quelle défense serons-nous capables, si nous ne sommes jamais attaqués ? On joue toujours lâchement les jeux où l’on veut être maladroit sans risque. Un volant qui tombe ne fait de mal à personne ; mais rien ne dégourdit le bras comme d’avoir à couvrir la tête ; rien ne rend le coup d’œil si juste, que d’avoir à garantir les yeux. S’élancer d’un bout d’une salle à l’autre, juger le bout d’une balle encore en l’air, la renvoyer d’une main forte et sûre, de tels jeux conviennent moins à l’homme, qu’ils ne servent à le former4.
La mère. Nous devrions toutes suivre les conseils contenus dans ce passage énergique, bien fait pour rassurer notre tendresse souvent trop craintive… Mais passons à un autre exercice. Vous regardez sans doute la natation comme la partie de la gymnastique la plus utile et la plus recommandable ?
J.M. Caillau, oui, sans doute ; et qui pourroit ne pas la regarder comme telle ?
La mère. […] J’ai toujours considéré l’art de nager comme un art très-important ; aussi j’ai eu soin d’y former Adolphe de bonne heure. Vous devez avoir remarqué que les enfans aiment naturellement l’eau, et en s’y prenant dès le bas-âge, on réussit très-bien, parce que à un an, l’enfant qui ignore le danger n’a pas la crainte salutaire des garçons de 5 à 6 ans, qui rarement osent se fier à l’élément liquide et qui craignent toujours d’enfoncer. Sous la garde d’un nageur habile, la natation n’est jamais dangereuse ; et s’il y a des jeunes gens qui se noyent en apprenant à nager, c’est toujours l’imprudence ou la témérité qui en sont cause…
Je me serois encore livré aux charmes de cet entretien, si le père d’Adolphe n’eut donné la retraite, et donné l’ordre d’atteller. […] Permettez-moi, dis-je à sa tendre mère, de laisser à cet aimable enfant un léger souvenir de cet entretien… J’avois par hasard dans ma poche un vol. in-18, imprimé chez Didot, et relié avec soin. Tiens, dis-je à Adolphe, accepte ce petit présent, ce sont les fables de La Fontaine, qui fut toujours l’ami de l’enfance, et qui sera longtemps le charme de tous les âges. Les œuvres de ce bonhomme renferment tous les préceptes de la sagesse. En le lisant, songe qu’il faudra un jour les pratiquer dans le commerce de la vie. Adolphe prit le livre, écouta attentivement ma leçon, et me remercia par un baiser… La séparation fut bientôt faite. Puisse cette aimable famille goûter long-temps le bonheur attaché à la bonne éducation des enfans, et recueillir un jour tous les fruits que donne cette intéressante culture !
Pistes bibliographiques
Anne de Mathan, « Journal des mères de famille », Gilles Feyel (dir.), Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution, 1789-1799. La presse départementale, tome IV, p. 312-319.
Dominique Julia, Les trois couleurs du tableau noir, Paris, Belin, 1981.
Anne Verjus, Les femmes et le vote 1789-1848, Paris, Belin, 2002.
Anne Verjus, Le bon mari. Une histoire politique des hommes et des femmes à l’époque révolutionnaire, Paris, Fayard, 2010.
Jean-Clément Martin, La Révolte brisée. Femmes dans la Révolution française et l'Empire. Paris, A. Colin, 2008.
Dominique Godineau, Les femmes dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, A. Colin, 2015.